Maurice Bourgeaux alias Maurice Duhamel
(Rennes 23 /02 /1884 – Rennes 05/02/1940)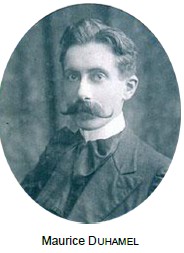 En octobre 2021 c’est M. Grégoire Scherfling, un étudiant en Histoire à l’UBO, qui prenait contact avec l’Amélycor pour en savoir davantage sur l’enfance et l’adolescence de celui dont il avait fait le sujet de son master 2, un ancien élève du lycée de Rennes nommé Maurice Bourgeaux, mais que l’on ne connaît guère que sous son pseudonyme : Maurice Duhamel.
En octobre 2021 c’est M. Grégoire Scherfling, un étudiant en Histoire à l’UBO, qui prenait contact avec l’Amélycor pour en savoir davantage sur l’enfance et l’adolescence de celui dont il avait fait le sujet de son master 2, un ancien élève du lycée de Rennes nommé Maurice Bourgeaux, mais que l’on ne connaît guère que sous son pseudonyme : Maurice Duhamel.
Ce fut une découverte.
• Découverte de l’élève Maurice Bourgeaux
Fils d’un corroyeur devenu grâce à un « beau » mariage négociant en charbon1, rue Saint-Hélier, près de la gare, Maurice Bourgeaux a eu une trajectoire scolaire un peu particulière. Il a déjà 10 ans quand il rejoint le petit lycée en 9ème où il brille en orthographe (1er prix) mais aussi en grammaire, calcul, leçons de choses et lecture (accessits). Succès qui se confirment en 8ème où il rafle les 1ers prix en Langue française, Histoire-Géographie, Dessin, mais aussi… »langue anglaise » qui restera un de ses points forts.
Est-ce pour ces excellents résultats qu’on lui fait « sauter » la 7ème ? toujours est-il qu’en 1895-1896, nous le retrouvons en 6ème classique sous l’autorité de M. Magerand. De la sixième à la terminale son nom apparaîtra dans tous les palmarès mais « seulement » pour des accessits (parmi lesquels figure toujours la langue anglaise) sauf en 1901-1902, en terminale, où il obtient le 1er prix d’honneur en Dissertation Française. Si l’on sait qu’il mène en parallèle à ses études au lycée, une brillante scolarité au Conservatoire de musique de Rennes qui lui prend beaucoup de temps, force est de convenir que Maurice Bourgeaux est alors un élève remarquable.
Remarquable et singulier. Dès la classe de seconde, de nouvelles passions se sont ajoutées aux études et à la musique.
On est en 1899-1900 et Maurice Bourgeaux a 15 ans.- Le second procès Dreyfus qui se tient dans son lycée en 1899, l’a bouleversé et poussé à agir. Dreyfusard, il a suivi les
audiences et en a envoyé les comptes rendus à Paris, à la revue L’étudiant, écho du quartier latin. De cette époque date son éveil à l’action politique.
– L’Affaire et peut-être aussi la langue anglaise, lui ont probablement fait connaître Emile Masson (1869-1923) néolicencié ès lettres qui, en 1898-99, à son retour de deux années de congé en Angleterre, venait d’être nommé répétiteur d’anglais au lycée ; il le retrouvera dans le « mouvement breton » qu’Emile Masson embrasse à partir 1906.
– C’est aussi en 1899 que Maurice Bourgeaux adresse un de ses poèmes à l’hebdomadaire littéraire rennais Le Clocher Breton qui le publie sous le pseudonyme de Maurice du Hamel. Ce nom à peine modifié deviendra son nom de guerre : Maurice
Duhamel
• Maurice Duhamel, le musicien et le militant breton
M. G. Scherfling qui a soutenu son mémoire fin octobre, aura l’occasion de nous faire part du résultat de ses recherches quand son emploi du temps s’y prêtera. Nous nous contenterons d’une esquisse de ce que fut la trajectoire de Maurice Duhamel.
1 Suivant l’acte de mariage et les recensements Ernestine Eugénie Aubin, sa femme, est « propriétaire », sa famille loge dans une grande maison neuve où servent deux domestiques et avant de pouvoir se mettre à son compte il a été comptable comme son beau-frère dans l’affaire de son beau-père.
2 Revue dont, ayant gagné Paris le bac une fois en poche, il deviendra le directeur en 1903
3 « J’avais fait la connaissance de Masson quand il était répétiteur au lycée de Rennes, aux temps héroïques de l’Affaire … », G. DOTTIN, nécrologie d’Emile
Masson, Annales de Bretagne, 1921 [sic] /35-4/ p 686. Egalement « Lycée impérial de Rennes, Personnel des fonctionnaires »[registre].
Maurice DUHAMEL
Le lycée en l’an 1900. Photo de l’élève Léon Gallet
Tout est parti de ses exceptionnelles qualités de musicien. Elles sont au coeur de la plupart de ses initiatives et occupations.
Le pianiste – interprète à l’occasion de chansons bretonnes – est devenu musicologue ; et l’ethnomusicologie appliquée à la Bretagne
a mené l’artiste à s’intéresser aux chants collectés sans musique au XIXè siècle en particulier par François-Marie Luzel (1821-1895).
Il apprend le breton pour comprendre ces textes, pour lui doublement muets, puis de 1909 à 1912, il part à la recherche de
ceux qui les chantaient encore, pour en collecter les mélodies. S’ensuivaient parfois des notations « en direct » des soniou mais il a le
plus souvent travaillé « indirectement » à partir d’enregistrements phonographiques sur cylindre dont Pierre Vallée était le grand
spécialiste.
Ces travaux aboutissent à deux types d’ouvrages : son étude structurelle des gammes et du style propres à la musique bretonne débouche sur le traité Les 15 modes de la musique bretonne tandis que les chansons et de leurs variantes sont publiées dans les pages de la revue Les chansons de France dont il était rédacteur en chef et dans son livre de 1913 : Musique bretonne.
Organisateur de concerts, harmonisateur de chansons, compositeur, chef d’orchestre à l’occasion, il était très attentif aux médias et tout particulièrement aux potentialités de la radio. Les rubriques « radio » du journal l’Ouest-Eclair permettent de mesurer sa participation à l’animation des 16 heures d’émissions musicales de Radio-Rennes (qui émet depuis 1927) dont il fut même, un temps, le directeur (novembre 1932 – juillet 1933).
Un tel engagement dans la culture bretonne marchait naturellement de pair avec un engagement régionaliste qui n’allait pas sans interrogations sur les objectifs à poursuivre comme sans lutte entre « lignes » et « clans ». C’est ainsi qu’après avoir adhéré à l’Union régionaliste bretonne (URB) Duhamel et ses amis en démissionnent dès 1912 pour participer à la création de la Fédération régionaliste bretonne.
Vient la guerre que Maurice Duhamel ne fait pas : il est réformé depuis 1904, officiellement en raison de sa « petite taille », sans doute aussi par « pacifisme ».
Après la guerre, le « mouvement breton » – auquel nombre d’artistes tels les plasticiens des Seiz Breur participent avec vigueur – est marqué en 1927 sur le plan politique par la transformation du Groupe régionaliste breton structuré dans l’immédiate après-guerre, en Parti autonomiste breton. Membre de son comité directeur, Duhamel devient rédacteur en chef de l’hebdomadaire du nouveau parti, Breiz Atao 2ème manière, dont la ligne est encore fédéraliste et plutôt de gauche. En 1931, lorsque sous la poussée des « nationalistes », ce parti devient le Parti National Breton, Maurice Duhamel en démissionne. Il meurt prématurément d’un cancer en février 1940, n’ayant pu achever que la
première partie de son Histoire du peuple breton… qui s’arrête en 1532.
Agnès Thépot
_____________________